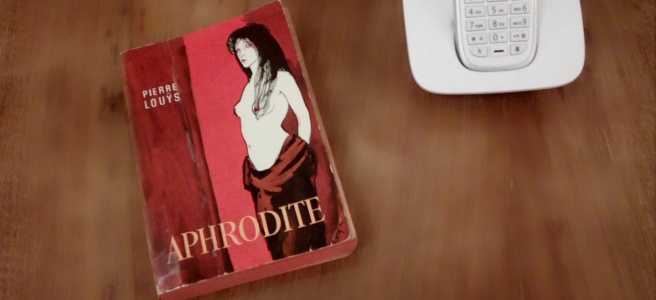Du temps que je vivais seul et que je voyageais beaucoup, je n’avais que des amours de voyage. Quand je rentrais chez moi, personne. J’étais content de retrouver l’appartement désert, de n’avoir pas besoin de parler, marchant dans des pièces vides, dormant à toute heure, prenant mes repas en lisant.
Quand même, à chacun de mes retours, j’aimais que ma tanière soit propre, pimpante. Le charme ne jouait pas si j’étais accueilli par un désordre de vaisselle, un amas de papiers et de serviettes jetées en catastrophe pour ne pas rater l’avion ou le train. Par l’entremise de la concierge, j’avais trouvé une gouvernante, une fée diligente qui veillait sur mon logement en mon absence, faisait le ménage, la lessive, les courses et me laissait ses instructions, sur la console de l’entrée, à l’encre bleue.
Souvent, il y avait des fleurs dans le vase, une coupe pleine de fruits de saison, de la bière glacée au frigo. Toujours, les draps étaient frais, les toilettes immaculées, et les rares lettres que je recevais posées sur mon bureau. L’air était pur, presque alpestre. La réserve de café, pleine de dosettes plus précieuses que des pièces d’or. Je bénissais Belinda.
Je l’appelais Belinda, mais je ne l’avais jamais vue. C’est le nom que m’avait donné la concierge, mais je n’avais jamais entendu sa voix. Elle avait la clé. Il y avait une enveloppe avec de l’argent liquide. Elle prenait ce qu’il lui fallait et glissait en retour les tickets de courses et le décompte de ses heures. Tout se passait dans l’invisible, par un échange de civilités signées de nos seules initiales. « Il faudra appeler le plombier pour la chasse d’eau. Voilà sa carte. B ». « Les pêches étaient mûres à point. Merci. Laissez les stores ouverts pour les plantes. L ».
Par la concierge, elle connaissait les dates de mes absences, et n’officiait que quand je n’étais pas là. Tout était prêt à mon retour. Une fois rentré, je m’occupais moi-même des courses, du linge, et tant bien que mal, de l’entretien des points d’eau. C’était paradoxal, cette intendance en deux temps, mais ça s’était décidé comme ça à l’origine et ça continuait.
Un après-midi, en revenant d’un séjour de repérage au Luxembourg – je baignais encore dans une sorte d’ennui lunaire – traînant mon sac-cabine sur le seuil de l’immeuble, j’ai croisé une belle jeune femme rayonnante, aux cheveux en torsades d’or roux, une véritable princesse vénitienne, qui devant mon air fasciné, m’a décoché un grand sourire. Rien qu’à la sentir s’éloigner, dans sa splendeur, j’étais prêt à planter là mon bagage, à la suivre sous les arbres de ma rue. Mais bon, suivre une inconnue, ce n’était pas à l’ordre du jour. La vie continuait.
J’ai sonné chez la concierge pour lui dire que j’étais rentré et lui offrir un cake glacé aux clous de girofle, délice local de Mondorf-les-Bains. La concierge était une Espagnole entre deux âges, très vive:
- Vous l’avez vue ? Vous l’avez vue ?
- Qui ?
- Belinda ! Elle sort d’ici à l’instant !
Me lancer à la poursuite de l’inconnue ? C’était sans doute la seule chose à faire. Mais la paresse, la politesse et la pudeur m’ont retenu. J’ai hoché la tête. J’ai traîné mon sac sans forme dans l’escalier. J’ai manœuvré la serrure.
Il y avait un léger parfum moelleux dans le hall d’entrée, une présence enivrante et subtile, qui a lutté un instant contre l’odeur d’encaustique et de canard WC, avant de s’évanouir.