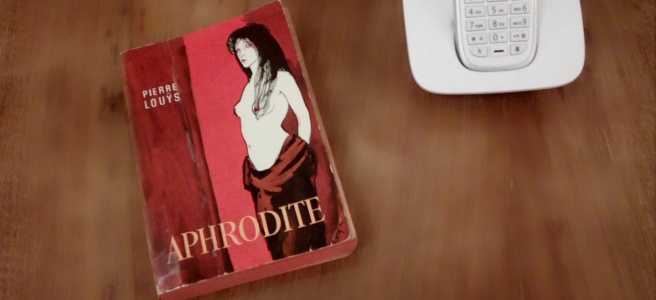Nous autres, Français de l’exil, nous ne savons pas si nous regagnerons un jour la planète-mère. Mais nous nous arrangeons pour emporter, partout dans la galaxie, la vraie langue natale.
J’ai vécu plus de la moitié de ma vie hors de France. Cet écart n’a jamais eu la moindre influence sur ma géographie intime. Je regardais par la fenêtre ou par le hublot : je voyais la France, à perte de vue.
L’idée que la France contient le monde, et non le contraire, est évidemment intenable, mais je ne l’ai jamais lâchée. Partout où j’ai habité, c’était en France. Et le monde entier y avait sa place. Parfois bien sûr, il fallait un sérieux réglage rétinien pour faire surgir la France de Hong-Kong ou de Bagdad. Mais l’accommodement de l’œil finissait par s’accomplir. Le dessin de l’Eden, le feu de l’Histoire, le rire d’enfant du premier jour, couraient de case en case sur la marelle planétaire.
À l’occasion, un incident de parcours provoquait l’atterrissage brutal. J’étais obligé de dévisser le casque de mon scaphandre spatial. Naufragé en territoire inconnu. Je me sentais devenir étranger à moi-même et à mon sang. L’ondulation des paysages familiers prenait une tournure fantastique. Je clignais des yeux.
Pas de doute, j’étais ailleurs. Cette pagode, ce rire, cette barbe, cet oiseau, cette rivière, cette jupe, ce ciel pas du tout poitevin, ne laissaient aucune place au rêve. Il allait falloir parler une langue dialectale, boire du thé dans une tasse sans anse, conduire à gauche, planquer ses armes et ses lois, aimer en lunettes noires, dormir sans oreiller, danser sans accordéon. Il n’y avait pas le choix, tant pis, en avant la musique. Trois petits tours. Vite et bien.
Ma nonchalance et ma vitesse ont été des pavillons claquant au vent mauvais ; et les larmes que je versais en voyant les malheurs de ma patrie, de l’eau et du sel de France.
Quand le plaisir jaillissait, au fil de mes amours, quand coulait le foutre tutélaire, je savais bien que la substance qui sortait de moi était ma langue ; elle fécondait le vide autour de moi.
Tout cela, bien sûr, passait inaperçu. J’avais aussi peu l’air que possible d’un citoyen hexagonal. Je n’aimais que la vitesse et la pureté. Je n’étais pas Français d’un autre temps, mais d’aucun temps.
Je me souviens qu’enfant, quand je revenais de l’école, et que le train entrait en gare, je levais les yeux de mon livre et j’apercevais le nom de la ville sur les panneaux du quai : Louvain. Je reconnaissais les sept lettres de ce mot, et le A, le I, avec leur son clair, me disaient que j’étais arrivé. Or, ce souvenir est un mirage. Depuis longtemps, le français était interdit à Louvain, traqué, et aucun panneau ne pouvait plus porter ce mot-là. Partout s’affichait Leuven, la version flamande officielle. En vain, pour ce qui me concerne. Je crois n’avoir jamais lu le mot de Leuven. Je rectifiais mentalement. Chaque fois que c’était nécessaire, je lisais Louvain : et le O, le A et le I se dessinaient devant moi sans aucun fléchissement. Les lettres ont une couleur secrète. Ces trois-là étaient les couleurs de mon drapeau.